Quand on devient professeur, on s’inspire forcément de ceux qui ont jalonné notre apprentissage ; on garde une pensée émue pour ceux qui nous transmis la matière qui est devenue la nôtre ; on juge aussi toutes leurs insuffisances, en se promettant de ne jamais les reproduire.
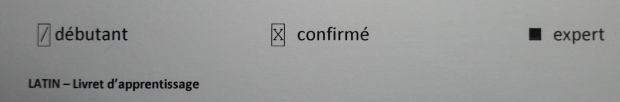
Je fais partie d’une époque où le latin se commençait en quatrième. Où les latinistes étaient concentrés dans la même classe. Et tous étaient germanistes. Mon prof de maths de 3e faisait visiblement cours pour 2 élèves ; que les 30 autres ne parviennent pas à suivre ne le préoccupait pas. Je fais partie d’une époque où l’élitisme était une chose instituée, normale… et générait des ravages qui me touchent encore aujourd’hui, à différents niveaux. Peut-être est-ce la raison pour laquelle je suis entrée en pédagogie Freinet ; peut-être est-ce celle pour laquelle je me sens à ma place en Education Prioritaire.
En cinquième, j’avais eu droit à la traditionnelle « initiation au latin », menée par mon professeur de français. Je n’en ai rien retenu, parce que je savais déjà que je m’inscrirais à l’option. C’était la norme chez les germanistes ; mes parents pensaient que je serais « dans une bonne classe » grâce à ce choix ; mais j’avais une raison personnelle : moi, je rêvais de comprendre tous ces mots gravés dans les églises et sur les tombes…
En quatrième, le premier cours s’est ouvert sur une phrase qui est restée gravée à tout jamais dans ma mémoire : Eo in ludum laete, « Je vais à l’école avec joie ». Soumise à un harcèlement qui durait déjà depuis de nombreuses années, et qui avait connu son paroxysme l’année précédente, je n’allais pas à l’école avec joie, mais avec peur. Force de la résilience ou amour des mots, j’ai évacué le mensonge de cette phrase et j’ai été fascinée par l’explication étymologique qui l’accompagnait. Ludum donne « ludique » ; laete donne « Laetitia ». Nous utilisions le manuel Salvete ! et le nom de mon professeur apparaissait dans les auteurs : était-ce elle, ou un homonyme ? je n’ai jamais su. Mais le cours était limpide et joyeux, et je me rappelle encore, tant d’années après, la façon dont elle nous avait enseigné l’accusatif. En civilisation, la fondation de Rome, bien sûr.
En troisième, la descente s’amorça. Nous utilisions Invitation au latin, mais nous n’en lisions jamais les textes. Une année entière à faire des exercices de déclinaison et de conjugaison sur des mots dont je connaissais à peine le sens. Et parfois, quand il fallait traduire une phrase dans un exercice, un vent de panique passait dans la salle, faute de vocabulaire. En civilisation, la fondation de Rome, encore.
En seconde, si j’ai eu un manuel, je n’ai pas dû m’en servir souvent, car je suis incapable de vous donner un titre. En revanche, je sais que c’est l’année où j’ai acheté ma « Cart et Grimal », une grammaire que j’ai apprise sur le bout de doigts. Et pour cause : révision des déclinaisons et des conjugaisons sur des mots vides de sens ; révision de la proposition infinitive, des subordonnée causales, temporelles, finales, de l’ablatif absolu. Des leçons de grammaire ad nauseam, aucun texte, encore moins de traduction – et bien sûr, pas de thème, ça, jamais. En civilisation, des exposés (les Etrusques, pour moi) et… la fondation de Rome, encore.
J’apprends que des camarades ont profité du passage en seconde pour mettre un terme à leur supplice, et je regrette de ne pas avoir fait de même. Après trois années de latin, je ne comprends toujours pas les inscriptions dans les églises… Mais l’hémorragie ne s’arrête pas là : nous étions 36 élèves à l’entrée en seconde ; nous ne serons plus que 8 à l’entrée en première. Dans ma classe de 1ère Littéraire, nous ne sommes que 2 à faire du latin. La traversée des Alpes, en somme.
Au cours de l’été qui précéda ma première, mes parents, qui ont toujours travaillé dans le privé, se renseignent comme ils peuvent sur les études que je devrais suivre pour devenir le professeur de français que je rêve d’être (depuis ma 6e !). Et m’expliquent doctement que, pour réaliser mon projet, il n’y a que deux solutions : l’agrégation de lettres, ou l’agrégation de grammaire. 😄 Ce n’est pas la seule erreur d’orientation que je vais connaître, mais celle-ci est la plus belle que j’aie jamais commise : fascinée et conquise d’avance par le mot « grammaire », discipline que j’adore, je comprends que, pour moi, le latin n’est désormais plus une option.
J’entre donc en première et là, le cours ne ressemble à rien de ce que j’ai connu, ou presque. Séance après séance, je dois écouter mon professeur traduire Tite-Live, puis Tacite ; il n’y a évidemment pas de manuel. Tout ce que j’ai appris prend son sens ; cependant la révélation se double d’un amer constat : je comprends comment faire… mais j’en suis incapable, faute de vocabulaire, faute d’entraînement.
A l’entrée en terminale, nous ne sommes plus que 5, et je suis la seule littéraire.
A cette époque, chaque élève choisit en dernière année un enseignement de spécialité, qui fait l’objet d’une épreuve écrite au baccalauréat. Je souhaite présenter la spécialité latin, mais elle n’est pas enseignée dans mon lycée. Je vais donc suivre, en parallèle, deux spécialités : maths, enseignée dans mon lycée, et latin, par le CNED. Incapable de réaliser les travaux demandés, je ne rendrai que deux devoirs, sur lesquels j’aurai passé de très longues heures pour un résultat assez médiocre. Sans surprise, j’opte pour la spécialité maths à l’inscription définitive au bac.
Je suis toujours l’option latin, et l’année entière est consacrée à la préparation de l’oral, avec les Tusculanes de Cicéron et le De rerum natura de Lucrèce. De la traduction à haute dose, et j’aime ça, même si je n’y arrive toujours pas. Je demande s’il est possible de commencer le grec ancien ; ça ne l’est pas ; en revanche, je peux faire de l’hébreu littéraire… et j’en fais. Je hais Lucrèce et croise les doigts pour tomber sur Cicéron ; coup de chance au tirage au sort ; je m’engueule littéralement avec mon examinateur, qui s’est gentiment foutu de moi – et je sors avec un 17 totalement inattendu.
Après tout un tas de péripéties que je vous passe, j’entre en « Lettres supérieures », c’est-à-dire en classe préparatoire au concours d’entrée à l’Ecole Normale Supérieure de la rue d’Ulm (que la rue d’Ulm, dans mon lycée, pas de Fontenay) ; avec une double inscription obligatoire, à l’université Paris IV-Sorbonne. Très rapidement, je comprends que je n’y ai pas ma place, tant le gouffre sociologique entre mes camarades et moi est immense, mais là n’est pas la question.
J’ouvre un Gaffiot pour la première fois de ma vie ; j’ai du mal à me séparer de ma « Cart et Grimal » au profit du Précis de grammaire latine (Gason, Baudiffier, Thomas), pourtant tellement supérieur ; j’apprends enfin, à haute dose, du vocabulaire, à commencer par la longue liste de verbes irréguliers comprise dans le Précis ; je découvre le « petit latin », cette analyse grossière du texte faite à l’aide de la traduction, pratique dont je suis incapable, faute de vocabulaire, toujours. Chaque samedi matin, il y a version sur table ; chaque samedi, j’aborde l’épreuve en me disant « Allez, cette fois, je vais y arriver » ; chaque lundi, mon professeur soupire en me rendant ma copie « Marjorie, il faut analyser… » ; je ne dépasserai jamais le 04/20.
En fin d’année, j’obtiens mon passage en khâgne, et j’y renonce. A la dernière colle de français, nous parlons de cette décision avec mon professeur (qui m’enseigne français et latin) ; comme il me demande si je rejoins les bancs des Lettres Modernes, je lui apprends que j’ai choisi les Lettres Classiques « parce que j’aime le latin. Je n’y arrive pas, mais j’aime ça. » Et là, tout sourire, il me dit que le latin a besoin de reposer en moi, et qu’à la rentrée, à l’université, je réussirai. J’ouvre des yeux ronds – il est fou, ça ne peut quand même pas être aussi simple.
Si.
Quel filou, ce M. Lequoy. J’espère qu’il a fini par obtenir la Ferrari de ses rêves, car il la mérite.
Imaginez ma stupéfaction lorsque la première version, à la fac, m’est revenue avec un 16/20. Je jette un œil sur la copie d’un camarade qui a pris 02/20, ma note habituelle, et je constate que sa traduction n’a aucun sens en français. Je me dis que c’est un coup de chance, mais la chance se répète de copie en copie, et à l’examen aussi. Aux partiels du 2e semestre, je suis interrogée par Dominique Briquel en personne, sur Cicéron, qui m’engueule parce que je connais la traduction, mais que je ne comprends pas les finesses du texte. Je ne suis toujours pas capable de faire du petit latin.
En licence, j’entre en Magistère d’Antiquité Classique, une formation spéciale de la Sorbonne ; je fais donc beaucoup d’histoire et d’archéologie, et je me demande pourquoi il n’y en a pas plus dans ma formation initiale ; je commets deux grosses erreurs dans le choix de mes options : je ne passerai jamais l’agrégation de grammaire et ne suivrai jamais aucun cours d’étruscologie, mes deux rêves d’enfant. Je découvre, ébahie, fascinée, la stylistique latine – qui deviendra mon domaine de spécialité. Je me cache sur mon banc à chaque fois qu’il faut improviser une traduction. Je scande l’hexamètre plus vite que mon ombre, mais je ne suis toujours pas capable de faire du petit latin.
Je suis devenue une latiniste à part entière. Une latiniste très imparfaite, qui finira par l’être moins à force de pratiquer la version et le thème – le thème surtout ; une latiniste qui surmontera finalement l’épreuve du petit latin ; une latiniste, enfin, qui s’est juré de ne jamais enseigner la grammaire sur du vide, et de travailler le vocabulaire plus qu’autre chose. Quand elle aurait réussi à être prof, et ça, c’était pas gagné – mais c’est une autre histoire.
Et vous, quel est votre parcours de latiniste ?
…
Un matin, comme je monte dans le RER, ma prof de latin de Terminale en descend. On se reconnait, on se salue avec plaisir. Elle me demande comment je vais ; en quelle année je suis ; ce que je deviens. La sonnerie qui annonce la fermeture des portes retentit.
J’ai crié, pleine de fierté : « Je suis en Lettres Classiques ! »
Tout était dit, et notre rame est partie.